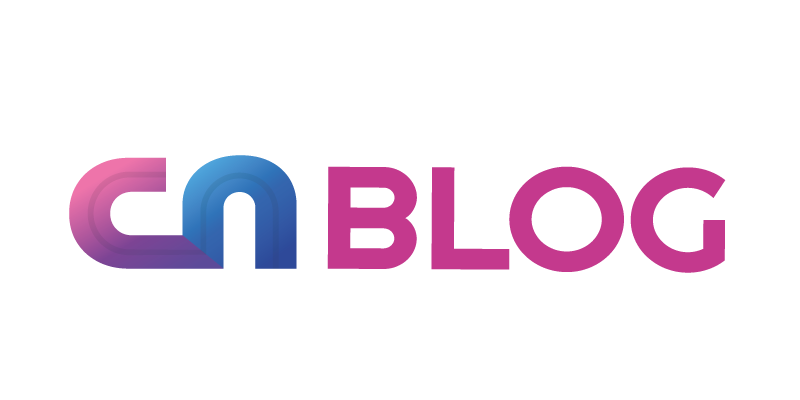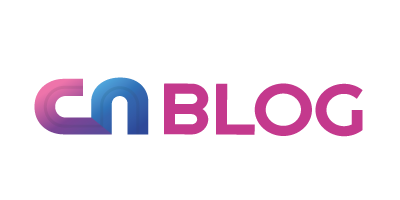En France, l’état civil ne reconnaît officiellement que deux mentions de sexe, malgré l’existence d’identités de genre en dehors de ce cadre. Plusieurs institutions adaptent discrètement leurs formulaires pour inclure une troisième option, tandis que d’autres s’en tiennent strictement aux cases traditionnelles. Les tribunaux tranchent parfois en faveur d’une mention « neutre », mais la jurisprudence reste instable.
Dans ce contexte, la question du vocabulaire se pose : le choix du mot juste pour désigner une personne non binaire varie selon les milieux, les langues et les préférences individuelles. Les usages évoluent, sans consensus généralisé.
Comprendre la non-binarité : au-delà du masculin et du féminin
La non-binarité bouleverse le modèle classique du genre masculin ou féminin. Nos institutions, notre langue, tout semble conçu pour ne penser le genre qu’à travers ces deux options. Pourtant, la palette des identités de genre ne se limite pas à ce duel binaire. La catégorie de personne non-binaire vient nommer celles et ceux qui refusent d’entrer dans ces cadres, ou qui les dépassent tout simplement.
Il ne s’agit pas seulement d’apparence ou de vêtements. Ce qui est en jeu, c’est la catégorie dans laquelle la société range chaque individu dès la naissance, en fonction de critères biologiques, sans leur laisser voix au chapitre. Or, une personne nonbinaire peut avoir été déclarée « homme » ou « femme » à la naissance, sans jamais s’identifier à ce genre. Face à la diversité des parcours, la binarité des genres n’a plus la même évidence.
Pour mieux cerner les termes clés de la non-binarité :
- Identité de genre : ce que chaque individu ressent, au-delà de la case homme, femme, les deux, ou aucune des deux.
- Genre binaire : système qui ne connaît que deux genres, mutuellement exclusifs.
- Genre neutre : se situe entre ou en dehors du masculin et du féminin.
La non-binarité n’est pas un mot parmi d’autres : il porte l’histoire des luttes, des affirmations, des refus. Derrière ce terme se déploient des trajectoires singulières, où orientation, expression de genre et vocabulaire choisi forment un puzzle complexe, loin des certitudes imposées par la norme binaire.
Quels mots et pronoms pour désigner une personne non binaire ?
La langue française, héritière d’une tradition binaire, propose peu de termes neutres pour parler d’une personne non-binaire. Pourtant, de nouveaux mots gagnent du terrain, portés par des mouvements militants ou simplement par la nécessité du quotidien. « Iel », mélange de « il » et « elle », s’est fait une place, rejoint par « ael », « ol », « ul », « al », « ille » ou « ælle ». Ces pronoms neutres marquent une rupture avec l’idée que le genre se résume à deux pôles figés.
Voici quelques exemples concrets de ces usages :
- Iel : désormais présent dans certains dictionnaires, repris dans les médias, il s’impose comme alternative à « il » ou « elle ».
- Ael, ul, ol : d’autres pronoms neutres, utilisés dans des cercles militants ou des communautés spécifiques.
- Mot épicène : des mots comme « personne », « individu », « membre » permettent d’éviter toute marque de genre.
L’écriture inclusive propose elle aussi des pistes : points médians dans les accords, doublets, adjectifs neutres. Dire « iels sont engagé·es », « fier·es » n’est pas un caprice ou un effet de style, mais une façon d’offrir visibilité et reconnaissance à toutes les identités de genre.
Certain·es optent pour une civilité neutre telle que « Mx », d’autres s’en tiennent à leur prénom ou adoptent un néopronom. Ces choix reflètent la pluralité des vécus. Lorsque le doute s’installe, demander à la personne concernée quel pronom ou quel terme utiliser reste la démarche la plus simple et la plus respectueuse.
Interactions respectueuses : conseils pour s’adresser à chacun·e
Entrer en relation avec une personne non-binaire secoue parfois nos réflexes, surtout dans une société où le genre est omniprésent. Les mots ne sont pas neutres : une erreur de pronom, un mégenrage, peut atteindre l’identité de l’autre. Utiliser le deadname, ce prénom que la personne ne reconnaît plus, expose à la dysphorie de genre. À l’inverse, nommer correctement nourrit une euphorie de genre qui, discrète, n’en est pas moins décisive.
Pour adopter une posture respectueuse dans ces échanges :
- Prêtez attention à la façon dont la personne se présente elle-même.
- S’abstenir d’interroger sur le parcours médical ou le genre assigné à la naissance sans demande explicite.
- En cas d’erreur, rectifiez simplement, sans vous justifier longuement.
N’hésitez pas à demander, de façon directe et décomplexée, quel pronom utiliser. Ce geste, simple, manifeste le respect de l’identité de genre de votre interlocuteur·rice. Si la situation reste floue, privilégiez le prénom ou choisissez des mots neutres comme « collègue », « membre » ou « camarade ». Cette attention vaut aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, lors d’un courriel, d’une réunion ou d’un échange informel.
L’enbyphobie, rejet ou moquerie envers les personnes non binaires, surgit parfois sous forme d’ironie ou de déni. Pour contrer ces attitudes, soigner le vocabulaire, respecter les coming out et faire preuve d’ouverture font la différence au quotidien.
Reconnaissance et visibilité : vers une société plus inclusive
La visibilité des personnes non-binaires, autrefois confinée à l’ombre, gagne aujourd’hui du terrain. Des artistes comme Sam Smith, Janelle Monae ou Miley Cyrus affichent publiquement une identité de genre hors du schéma binaire, amenant le débat sur la place publique. En France, comme ailleurs, la question devient brûlante : comment intégrer ces réalités dans la langue, dans les lois, dans la vie de tous les jours ?
Ce que l’on nomme finit par exister socialement. Adopter les bons termes, user de pronoms neutres ou d’accords dégenrés, ce sont là de véritables leviers de reconnaissance. Si l’administration peine à offrir des civilités neutres et que l’usage résiste dans la vie courante, chaque personne non-binaire mise en lumière, chaque récit partagé, fragilise un peu plus la barrière du genre binaire.
La langue française change, non sans débats. L’écriture inclusive, les néopronoms, le recours aux mots épicènes divisent mais témoignent d’une volonté de faire évoluer les mentalités. Renoncer à réduire le genre à deux pôles, reconnaître toutes les identités, c’est accepter de réinventer la société. Et cela ne s’arrête pas à une question de mots : il s’agit d’un pas vers une société inclusive, dans laquelle chacun·e peut se nommer et être reconnu·e.
Quelques points forts émergent dans cette dynamique :
- Nommer, c’est accorder une place : chaque mot juste, chaque pronom respecté, rend visible l’invisible.
- Les représentations médiatiques influencent l’opinion publique et peuvent ouvrir la porte à de nouveaux droits.
Changer un mot, c’est parfois ouvrir un monde. Et si demain, la diversité des genres n’était plus une exception mais une évidence ?