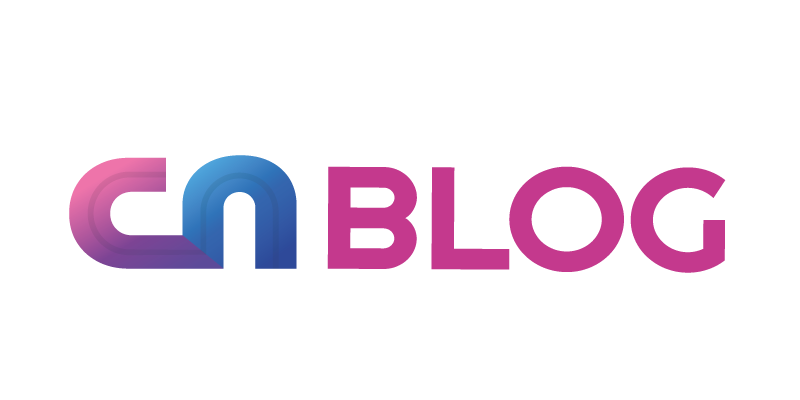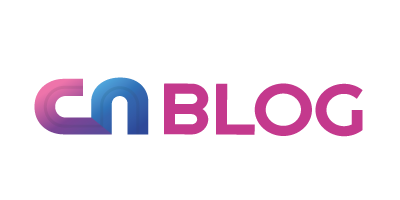Certains chiffres bousculent plus que des discours. 63 % des jeunes de moins de 25 ans en France affirment ne plus se reconnaître dans la séparation stricte entre vêtements « pour hommes » et « pour femmes ». Pendant ce temps, des enseignes persistent à diviser leurs rayons, là où la législation européenne avance pas à pas contre les discriminations. Des règlements scolaires continuent de proscrire la jupe à certains élèves, mais tolèrent sans sourciller d’autres habits, tout aussi chargés de stéréotypes.
Dans les coulisses de la mode, la tension monte. Les clients, notamment les plus jeunes, réclament des vêtements qui ressemblent à leurs identités multiples, pas à des cases déjà remplies. Les vieux codes vestimentaires, autrefois gravés dans le marbre, se retrouvent aujourd’hui au cœur des débats et des revendications. La mode, loin d’être un simple décor, devient un champ de bataille où se jouent les questions de genre, d’inclusion et d’expression de soi.
Le vêtement, bien plus qu’un simple habit : un miroir de nos sociétés
S’habiller n’a jamais été un geste neutre, jamais un choix anodin. Un vêtement, c’est un marqueur, un signal, parfois même un manifeste silencieux. Les codes vestimentaires traditionnels n’ont rien d’universel ni d’intangible. Un regard sur l’histoire suffit à s’en convaincre. L’Antiquité laissait peu de place à la différenciation par le genre. C’est le Moyen Âge qui a posé les premières frontières : couleurs, coupes, tissus, le vestiaire devient territoire, et la séparation s’inscrit jusque dans les étoffes.
Vient la Renaissance. Elle renforce la démarcation par les ornements, les corsets, les braguettes, autant d’outils pour afficher le statut social et le genre. Mais cette répartition des rôles, loin d’être figée, évolue sans cesse. D’une époque à l’autre, d’un pays à l’autre, la façon dont on s’habille raconte tout autant notre place dans le monde que nos goûts personnels.
Le XXe siècle marque un tournant. L’émancipation vestimentaire des femmes bouleverse la hiérarchie des apparences. Les pantalons, autrefois bannis, deviennent symboles de conquête. Peu à peu, la remise en cause du cadre binaire gagne du terrain. Aujourd’hui, la déconstruction des stéréotypes de genre s’affiche partout : jeunes générations, célébrités, mouvements militants. On revendique la fluidité de genre, la non-binarité, la pluralité des expressions de genre. La mode n’est plus figée : elle s’ouvre, se transforme, interroge la manière dont le vêtement construit l’identité de chacun.
Le vêtement inclusif en matière de genre s’inscrit dans cette vaste mutation. Il ne se contente pas d’adapter la coupe ou la couleur. Il interroge les fondements mêmes de la représentation du corps et de l’identité de genre dans nos sociétés occidentales.
Pourquoi le genre s’invite-t-il dans nos penderies ?
La question du genre ne se contente pas de frapper à la porte des vestiaires : elle s’impose, portée par l’histoire et les mouvements sociaux. Qui se souvient que le pantalon était interdit aux femmes jusque dans les années 1960 en France ? Ce sont les mouvements féministes qui ont fait sauter le verrou, transformant le vêtement en symbole d’émancipation.
Des figures comme Marlene Dietrich et Greta Garbo, en tailleur ou en smoking, ont ouvert la voie. Plus récemment, David Bowie, Billie Eilish, Harry Styles ou Mark Bryan repoussent les frontières, brouillent volontairement les codes. La transgression vestimentaire ne se limite plus à quelques icônes : elle se diffuse dans la culture populaire, inspire des milliers de jeunes.
L’industrie de la mode suit, parfois de mauvaise grâce, parfois par conviction. Sous la pression des mouvements LGBTQ+ et des partisans de la neutralité, les créateurs imaginent des silhouettes androgynes, jouent avec les matières et les couleurs. L’influence de ces évolutions est palpable : le vêtement inclusif n’est plus un simple slogan. Il devient un outil concret pour révéler la diversité, pour donner à chacun la possibilité d’affirmer sa singularité.
Ce mouvement s’accélère grâce aux réseaux sociaux, qui mettent en avant des parcours variés et des corps longtemps ignorés. Le genre, loin d’être une étiquette immuable, s’affiche désormais comme un terrain d’inventivité, où liberté et créativité se conjuguent au pluriel.
Vêtement inclusif : entre revendication, liberté et créativité
Le vêtement inclusif n’est pas une tendance passagère. Il s’impose comme une revendication, un levier de liberté et d’engagement. Des marques comme Gucci, H&M ou Stella McCartney proposent aujourd’hui des collections unisexes, genderless ou genderfluid. Le vêtement devient alors moyen d’inclusion et d’affirmation.
Mais la diversité ne se limite pas à effacer la distinction entre genres. Elle interroge aussi la prise en compte de toutes les morphologies. Voici quelques dimensions concrètes de cette évolution :
- Du petit au grand : la taille ne devrait jamais être un obstacle à l’accès à la mode.
- Du mince au gros : l’offre s’élargit, la norme s’efface, la pluralité des corps s’impose.
Des initiatives comme Universal Standard, Make My Lemonade ou Kiabi incarnent cette nouvelle demande : offrir des vêtements accessibles à tous, sans restriction de taille. Les études de l’Institut Kantar montrent une attente réelle pour plus de diversité, mais aussi une vigilance face au curve washing, cette stratégie qui consiste à afficher un discours inclusif sans adapter réellement l’offre.
Sur les réseaux sociaux, des influenceurs et mannequins comme Paloma Elsesser ou Jill Kortleve imposent une esthétique nouvelle, valorisent la diversité, et contribuent à déstigmatiser la différence. Les consommateurs, aujourd’hui plus informés et plus exigeants, réclament une mode éthique, attentive non seulement au genre et au corps, mais aussi à son impact environnemental. L’inclusivité, ici, ne se limite pas à une question de style : elle engage la responsabilité des marques, et exige des actes concrets, loin des effets d’annonce.
Imaginer une mode où chacun·e trouve sa place
Aujourd’hui, la mode inclusive revendique une transformation profonde. Elle refuse la logique du modèle unique, balaie les normes imposées, et conteste le regard qui trie et hiérarchise. Le sur-mesure apparaît comme un idéal à atteindre : permettre à chaque personne de se vêtir selon sa propre identité, sans contrainte de genre, de taille ou de morphologie.
Pourtant, ce modèle se heurte à la réalité de la fast fashion, qui privilégie la rentabilité au détriment de la diversité, et à l’élitisme de la haute couture. Les consommateurs, eux, attendent des engagements clairs et des actes mesurables.
Des études menées en France et au Royaume-Uni le montrent : la demande pour plus de diversité et d’inclusivité est massive. À Londres, la fusion des défilés homme/femme marque une volonté de dépasser les frontières, alors qu’à Paris, la séparation persiste. En Thaïlande, la mise en avant des identités transgenres prouve que l’inclusivité se traduit déjà par des pratiques concrètes, et ne relève pas d’un lointain idéal.
Pour amorcer ce changement, plusieurs pistes peuvent être mises en œuvre :
- Prendre en compte les besoins réels des clients : tailles, coupes, matières adaptées à tous.
- Impliquer directement les personnes concernées dans la conception des collections.
- Repenser les modes de production pour éliminer les logiques d’exclusion.
La mode n’a jamais autant ressemblé à un laboratoire vivant. En s’ouvrant à la pluralité, elle devient un terrain d’expression pour tous. S’habiller, dès lors, ce n’est plus se conformer. C’est choisir sa place, chaque matin, dans une société qui apprend à regarder la différence autrement.